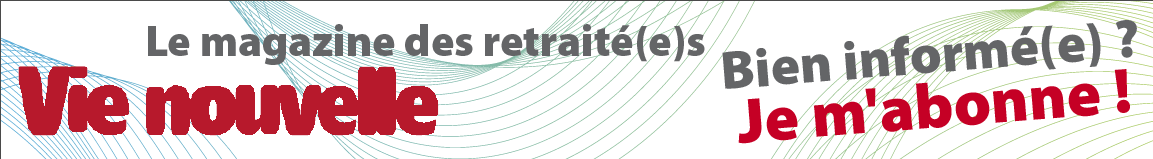Bernard Thévenet est un des grands champions cyclistes français des années 1970. Il affiche un palmarès impressionnant, au panthéon duquel figurent deux victoires dans le Tour de France en 1975 et 1977. Revêtu de son célèbre maillot à damiers noirs et blancs, sur les pentes du Ventoux, de l’Izoard ou de Pra-Loup, il nous a fait rêver. Rencontre avec un homme attachant.
Vous êtes né en 1948 dans une famille d’agriculteurs bourguignons et, ça ne s’invente pas, vous grandissez à Saint-Julien-de-Civry en Saône-et-Loire au lieu-dit « Le Guidon ». Comment le gamin que vous étiez alors découvre le vélo ?
Comme beaucoup d’enfants de mon âge, c’est à vélo que j’allais à l’école. Moi, c’était sur celui de ma sœur. À la maison, on parlait beaucoup du Tour de France. Je parcourais la page des sports du journal local L’Écho-Liberté. Elle était jaune… En 1961, l’étape du Tour, Nevers-Lyon, passe au village. L’enfant de chœur que j’étais se souvient que le curé avait avancé l’heure de la messe pour que nous puissions voir passer la course. Quelle émotion ! J’entends encore le sifflement du peloton. En voyant les cale-pieds rutilants des coureurs, je me suis dit qu’un jour je serais à leur place. En 1962, j’obtiens mon certificat d’études primaires et mes parents m’offrent mon premier vélo. Un magnifique demi-course. C’était parti.
Vous débutez votre carrière professionnelle en 1970. La même année, vous prenez le départ de votre premier Tour de France. Racontez-nous cette plongée dans le grand bain ?
En 1970, je signe mon premier contrat professionnel chez Peugeot. J’y resterai jusqu’en 1979. Évidemment, pas question de faire le Tour la première année. Mais, deux coéquipiers étant tombés malades, je suis sélectionné au dernier moment. Je me rappelle parfaitement mon arrivée à Limoges, ville de départ cette année-là. Inquiet, effrayé, mais très fier également. Tout le monde avait des vélos neufs, sauf moi. Je n’étais pas sur la liste des titulaires de l’équipe. Pourtant, je gagne une étape, le 14 juillet, à La Mongie. Ça a changé ma vie.
Ce 13 juillet 1975, tout bascule dans la montée vers Pra-Loup. Vous détrônez Eddy Merckx et devenez l’icône du cyclisme français. Quel souvenir gardez-vous de votre premier maillot jaune ?
Avant cette fameuse étape, il y a eu le Dauphiné Libéré que je remporte devant Merckx. Je réalise qu’il n’est pas un surhomme. Maurice De Muer, mon directeur sportif, m’a dit : « tu peux battre Merckx sur le Tour, il faut juste oser ». Alors, j’ai osé. J’avais, certes, le maillot jaune sur les épaules, mais je n’ai été tranquille qu’après l’arrivée à Paris. Avec Eddy, on ne savait jamais !
Sur le Tour de France, vous accompagnez des personnalités invitées. Parmi lesquelles Philippe Martinez et Bernard Thibault avec lequel, je crois, vous partagez un souvenir personnel. Vous nous racontez ?
C’était en 2007 ou 2008. J’apprends, avant le départ, que nous passerons dans le village Creusois où habitent les beaux-parents de Bernard. Pas question de ne pas s’arrêter un instant. Ce que nous avons fait pour le plus grand plaisir de tout le monde. J’ai le souvenir que lorsque les gens appelaient « Bernard », nous nous retournions tous les deux. Je me rappelle aussi l’accueil ému que lui ont réservé les mineurs de La Mure en lutte contre la fermeture du site. Bernard avait tenu à les saluer. Des grands moments d’humanité. J’ai pu mesurer, à cette occasion, que le Tour de France, c’est aussi le Tour de la France, dans toute sa diversité.
Quel regard portez-vous sur votre carrière ?
Je suis arrivé au plus haut niveau entre Merckx et Hinault. Alors, bien sûr, ça a dû limiter quelques ambitions. Mais j’ai toujours fait le maximum pour ne pas avoir de regrets. Une maxime qui devrait inspirer les jeunes. Quel que soit le domaine auquel ils se destinent.
Propos recueillis par Michel Scheidt
 Préparer ma retraite
Préparer ma retraite Vous vous interrogez sur la date exacte de votre départ à la retraite.Sur la date à partir de laquelle vous devez faire valoir vos droits à la retraite, les démarches à entreprendre, le montant de votre ou vos pensions...

 Mes droits en chiffres
Mes droits en chiffres Retraites, Pensions, Allocations, Minima, Sécurité sociale, CMU, APA, SMIC, RSA; Prix, Loyers...
 Ce qu'il faut savoir
Ce qu'il faut savoir CSG et CRDS des retraites en 2021 Nouveau !

Madeleine Riffaud ou la résistance au cœur
La vie de Madeleine Riffaud est un hommage à la résistance sous toutes ses formes et en toutes circonstances. Le 2ème tome de ses mémoires en images est paru ! Editions Dupuis